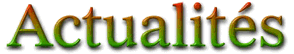
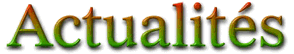
Note de la rédaction : Il y a des articles qui restent d'actualité et qui ont eu l'estime des lecteurs. Ce sujet est intéressant à l'approche des élections. La rédaction a décidé de le publier.
CRIMINALISATION SOCIO- ECONOMIQUE DU POUVOIR AU BURUNDI
Conférence animée par Gratien Rukindikiza à Bruxelles le 21 juin 2003
Introduction
Quand on parle de criminalité ou de crime, il ne s’agit pas seulement de sang, de mort. Il s’agit aussi d’infraction grave punissable par la loi à hauteur d’une peine déterminée.
On parle aussi de criminalité quand il s’agit de vol, de trafic illicite, de détournement de fonds etc… Au regard de la loi, le crime est constaté quand trois conditions sont réunies :
- Il faut que le délit soit prévu par la loi en tant que crime ;
- Il faut qu’il y ait une relation de cause à effet. L’acte posé doit être responsable du préjudice ;
- Il faut que le délit soit intentionnel. Personne ne peut être accusé d’un crime pour un fait accidentel. Elle peut être accusée de négligence mais pas de crime.
Par ailleurs, le cas qui nous concerne aujourd’hui n’est pas ce genre de crimes. Il y a d’autres formes de criminalité qui ne sont pas violentes mais qui causent beaucoup plus de préjudices à la population qu’un cambriolage ou un meurtre. Il y a aussi une forme de morts lentes. On peut citer l’injustice sociale, le détournement de fonds destinés à financer les médicaments pour la population.
Souvent, cette injustice est l’œuvre d’un pouvoir en place, garant théorique de la justice et de la justice sociale.
Cette injustice sociale conduit à une criminalisation socio-économique orchestrée par le pouvoir. Nous pouvons l’analyser en cinq points : la paysannerie, l’emploi et l’école, les soins de santé et la sécurité, l’initiative privée et l’aide publique internationale.
Ruine de la paysannerie par le pouvoir
La paysannerie burundaise serait en dépôt de bilan si elle était européenne. Sa situation est tellement catastrophique que le pouvoir a décidé d’adopter la politique de l’autruche. Il doit faire semblant de ne rien voir à l’image d’un médecin ayant en charge un patient qui ne peut pas être sauvé. La seule différence est que le médecin est impuissant par manque de moyens ou de médicaments. Or, le pouvoir a les moyens de sauver la paysannerie. Il ne le fait pas parce que ce n’est pas sa priorité.
L’agriculture est à l’état archaïque malgré les différents projets de développement, les centres de recherche agronomique. Les paysans qui habitent à un kilomètre de l’Isabu de Gisozi, centre de recherche créé dans les années 60, font la même agriculture que leurs parents. Combien de millions ont été engloutis dans cette Isabu pour payer les ingénieurs et les techniciens et tout le matériel sans que les paysans concernés n’en bénéficient pas?
Les paysans sont confrontés à la dualité des engrais chimiques et du fumier naturel. Ils n’arrivent pas à combiner les deux méthodes. Rares sont les techniciens agricoles qui rendent visite aux paysans pour se rendre compte de l’état réel de l’agriculture burundaise et écouter les doléances des paysans.
Le café est, depuis la colonisation, la culture la plus protégée. L’arrachage des caféiers est interdit. L’attention portée à cette culture a occulté la place des cultures vivrières des paysans burundais. Le travail consacré aux caféiers par rapport à son apport est moins productif que celui consacré à l’amélioration des méthodes d’agriculture. Le café rapporte à l’Etat les devises à hauteur de 90%. Ces devises servent à assurer le bon train de l’Etat, certaines dépenses de luxe, des médicaments et autres. Par ailleurs, la mauvaise répartition des revenus du café ruine la paysannerie. Elle produit une grande partie de la richesse nationale et est absente à la répartition des « dividendes ». Aucun système social n’est prévu pour les paysans, grands travailleurs burundais et piliers de l’économie burundaise. La bananeraie procure plus de revenus aux paysans que le café. Or, elle ne bénéficie d’aucun soutien de la part des pouvoir. Pire, le régime de Bagaza avait demandé aux techniciens agricoles d’imposer la diminution substantielle de la bananeraie sous le nom de l’« éclaircie de la bananeraie ».
Le combat bananeraie –caféier n’est pas déjà gagné par le pouvoir. Les paysans refusent de consacrer une bonne partie de la bananeraie aux caféiers. De plus, les paysans sont obligés d’observer impuissants le transfert de la biomasse au profit des caféiers. Ce combat cache aussi un autre combat ville-campagne. Il est aussi un des fondements de l’exclusion ethnique, du moins avant 1993. Si on considère que l’élite tutsi avait fait les études avec facilité et n’a pas été chassée du pays alors que les hutu instruits avant 1972 ont été tués ou exilés par un pouvoir dirigé par certains éléments de l’élite tutsi, on peut en déduire que la majorité de paysans hutu a produit une richesse qui a bénéficié à l’élite tutsi. Par ailleurs, les paysans tutsi ont subi le même sort que leurs collègues hutu tout en sachant que ceux ayant des enfants aisés bénéficient des miettes du gâteau.
Autoritaire et paternaliste, le vulgarisateur agricole transmet son savoir qui ne doit faire objet d’aucune contestation ou réflexion à la manière : « Exécute et tais-toi ». Au lieu de conseiller le paysan, il est devenu le policier le plus craint grâce à ses amendes qu’il inflige. Vulgarisateur, policier et percepteur : ces étiquettes compliquent les relations Etat- paysans Les paysans modèles qui sont les « références des paysans » burundais pour les politiciens sont en réalité une minorité nantie qui a fait appel à une main d’œuvre ou à des engrais chers. Le simple paysan, grand travailleur a peu de chances pour devenir un « paysan modèle ». Le caractère répressif de la vulgarisation agricole a fini par décourager les initiatives des paysans et a bloqué le développement de la paysannerie.
Les parcs nationaux, tant présentés comme une protection de la nature, ont été un échec pour le citoyen burundais. Nous prendrons l’exemple du parc de la Ruvubu. Ce parc national a été créé dans un endroit dépourvu d’animaux sauvages. La reconstitution de ce parc s’est accompagné d’une expropriation de plus de 3 000 familles paysannes et d’une réserve de 50 000 hectares. Le coût de reconstitution de ce parc aurait servi à repeupler cette région voisine des provinces surpeuplées. On peut défendre la protection de la nature. Elle ne doit en aucun cas fragiliser la vie des paysans. Faut-il défendre un projet de parc national du fait qu’il bénéficie d’une aide international au détriment de l’agriculture ? L’expropriation est plus ressentie comme une humiliation . Les paysans reçoivent une indemnité à prendre ou à laisser, non négociable.
Il s’agit de savoir en quoi le parc avantage le paysan, même à long terme. Le plus souvent, derrière l’aménagement du parc se trouve un projet de détournement de fonds par certains dirigeants. Le parc de la Ruvubu n’est pas jusqu’aujourd’hui peuplé d’animaux sauvages tant promis. Il est devenu le parc d’entraînement militaire des unités militaires de Muyinga et Mutukura. Il serait intéressant de savoir comment l’Etat major de l’armée pourrait accorder la permission à ces unités pour faire des manœuvres dans un parc national si en réalité, le projet a été réalisé. Le parc, que je connais bien, n’a rien à voir avec un parc d’attraction de touristes. Il attire tout au plus quelques chasseurs à la poursuite des lapins.
Les projets de reboisement, d’aménagement rizicoles ou de parcs nationaux sont souvent à l’origine des expropriations des paysans. L’exemple le plus frappant est celui des aménagements rizicoles de l’Imbo centre et des palmeraies de Rumonge. Une bonne partie des terres a été attribuée aux hauts fonctionnaires de l’Etat et aux officiers. L’expropriation pour cause d’utilité publique est devenue une expropriation pour cause d’utilité privée. Les paysans ont été expropriés au profit de cette classe déjà nantie.
Le conflit Etat- paysans a été accentué par le mépris des citadins, fonctionnaires, salariés à l’égard des paysans. Combien de fois traite- t-on les gens au Burundi d’espèce de paysan ? On parle de l’intérieur du pays quand on quitte la capitale. Certains croient même que le ministère de l’intérieur s’occupe de l’intérieur comme on le dit. Peut-être qu’on s’est trompé, le ministère des relations extérieures devait s’occuper des relations entre l’intérieur et la ville de Bujumbura.
Le mépris du paysan orchestré par l’Etat devient souvent cynique. A partir de quel nombre de morts paysans le pouvoir s’alarme-t-il ? 50 morts, paysans, victimes des bombardements de l’armée n’attire pas l’attention du pouvoir. Il suffit de diviser par 10 ce chiffre et le rapporter sur la capitale. 5 citadins tués dans la ville de Bujumbura déclenche une alerte générale du pouvoir. Le gouvernement se réunit d’urgence et cherche des solutions. Le paysan hutu ou tutsi est un sous- citoyen pour le pouvoir ; sauf quand il s’agit des élections.
L’emploi et l’école : outils d’exclusion du pouvoir
En dehors de la profession d’agriculteur, l’Etat est le grand employeur burundais. Il emploie des salariés non qualifiés et qualifiés. Certains postes techniques ne posent pas de problème. Un instituteur enseigne les élèves en général que ce soit à Bururi ou à Muramvya, hutu ou tutsi. Il n’y a pas de règle sans exception. Certains salariés, sur des critères non définis, sont désignés à d’autres postes de responsabilité. Ils doublent ou triplent leurs revenus du seul fait qu’ils ont été pistonnés. Le système devient injuste quand il s’érige sous une forme de promotion d’une région, d’une ethnie , etc…en excluant l’autre région, ethnie etc…
Au sein de l’appareil étatique, l’armée est le grand employeur de tous les ministères. Or, depuis 1972, les hutu ont été exclus de l’armée après leur élimination physique de l’armée. Pendant plus de deux décennies, le grand employeur a exclu une ethnie. Le crime de l’appareil étatique est d’avoir refusé l’accès à l’armée aux hutu, seul employeur qui embauchait plus de mille salariés par an sans aucun diplôme. Je ne polémiquerai pas sur le pourcentage d’hommes de troupe, de sous officiers et officiers hutu dans l’armée. Ce problème de l’armée sera analysé dans le paragraphe de la sécurité.
Au niveau des emplois qualifiés, il va de soi que celui qui ne dispose pas de piston aura du mal à être promu. Compte tenu de l’histoire burundaise, les hutu avaient moins de chances depuis 1972, année pendant laquelle les intellectuels hutu ont été soit tués, soit contraints à l’exil. Ainsi, la jeune génération subit un jeu inégal dans un système de promotion sans règle. L’emploi s’est érigé en rempart pour bloquer l’ascension d’une certaine catégorie de la population pour des critères ethniques ( hutu) ou régionaux (Bururi contre Muramvya). Je ne globaliserai pas car tous les habitants de Bururi n’ont pas bénéficié du gâteau comme tous les tutsi n’en ont pas bénéficié.
L’exclusion du pouvoir d’une certaine catégorie de population à un certain nombre de postes se fait aussi à l’aval.
Ainsi, l’école sert, pour un pouvoir mal intentionné comme on l’a constaté plusieurs fois, à couper l’herbe sous les pieds d’une catégorie de population qui pourrait revendiquer le pouvoir à moyen ou long terme. Un véritable génocide intellectuel a été pratiqué par le pouvoir sans qu’il attire l’attention de l’élite burundaise. Ce génocide était la suite du génocide physique de 1972.
Depuis l’école primaire, le concours national est triché par ceux qui ont les moyens pour favoriser les enfants de leur famille. Pire, certains enfants hutu ont « échoué » le concours du seul fait qu’ils étaient hutu. Souvenez-vous de l’histoire de « I » et de « U ». Il y a d’autres cas de tricheries des enfants dont leurs noms ont été carrément repris par d’autres ayant échoué le concours. J’en connais des exemples. Demandez à un militaire combien de collègues ont deux noms ; un pour l’armée et un autre pour sa famille. N’est-il pas un crime de condamner un enfant à abandonner l’école non pas parce qu’il n’est pas intelligent, mais parce qu’il est né hutu, ou même tutsi de Kayanza ou Muyinga ?
Le système d’orientation a aussi contribué à exclure. Une certaine catégorie d’élèves était envoyée à l’école moyenne pédagogique ou à l’école de formation des instituteurs alors que d’autres élèves d’un niveau intellectuel plus bas se retrouvaient au lycée pour accéder à l’Université. Le système a été affiné avec la répartition des écoles secondaires et l’adoption du principe de rapprochement des élèves de leurs communes de naissance. Regardez la carte scolaire du Burundi, vous comprendrez que l’élève de Ngozi ou Kayanza a moins de chances d’accéder à l’université que celui de Bururi ou de Muramvya.
A l’université du Burundi, l’image ethnique des facultés de l’économie et de droit ( facultés destinées aux futurs dirigeants administratifs ou dans le privé) renvoie à celle de l’armée. Je ne parlerai pas d’un système d’exclusion. Je dirai tout simplement qu’une réorientation d’un étudiant pour entrer dans une de ces deux facultés était déjà difficile pour les tutsi de certaines régions, pour les hutu, c’était une mission presque impossible.
Ces exclusions encouragées par le pouvoir constituaient des crimes à l’égard des personnes visées.
Un exemple frappant de l’exclusion qui n’est pas du ressort du hasard est celui des directions des entreprises publiques. Sur un échantillon de 36 sociétés publiques ( chiffres de 2001), 32 dirigeants sont tutsi et 4 sont hutu. 23 sont originaires de Bururi, 5 de Muramvya, 2 de Ruyigi, 2 de Muyinga, 1 de Gitega, 1 de Kayanza , 1 de Bujumbura rural et 1 de Bujumbura. Si ces nominations sont liées aux compétences de ces hommes, en d’autres termes « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut », je dirai que la loi des probabilités à été inventée par un burundais.
Les soins de santé et la sécurité : instrument d’élimination physique par le pouvoir
Le pouvoir burundais a tué directement et indirectement. Il est coupable de ces meurtres. Nous n’avons pas l’intention de nous focaliser sur les événements de 65, 69, 72 et 93. Le pouvoir dispose de deux moyens pour tuer ou sauver ses citoyens. Les citoyens meurent, sauf quelques cas d’accidents, du fait de la guerre ou de maladies. Seul l’Etat dispose des outils pour les sauver. Ne pas sauver ses citoyens est une non- assistance de personne en danger. L’Etat a la mission de protéger ses citoyens et d’assurer leurs soins de santé. Pourtant, il a failli à ses missions depuis son fonctionnement en tant qu’Etat.
Pour les soins de santé, le pouvoir continue d’opposer les bons citoyens des sous-citoyens, je parle des paysans. Les fonctionnaires, les salariés du privé ont droit aux soins de santé remboursés par une mutuelle. L’INSS organise tout le système pour les salariés. Le pouvoir s’occupe des soins de santé de moins de 10% de la population. Les paysans, représentant 90%, ne sont dans aucun budget du pouvoir pour les soins de santé. Comment font-ils pour se faire soigner? Posez la question au ministre ou au Président, la réponse m’intéresserait. Le paysan burundais a un revenu annuel moyen de 20 euros. Il lui est difficile de se faire soigner avec ce revenu. Sa seule chance pour vivre longtemps est de ne pas tomber malade. On parle de durée de vie des paysans. Evaluer la durée de vie des paysans est tout simplement se moquer du monde. Le pouvoir pourrait évaluer la durée de vie le jour où il pourra faciliter leur accession aux soins de santé.
Plus que la maladie, la sécurité est devenue un instrument du pouvoir pour faire peur aux prétendants. L’insécurité est le meilleur gardien du pouvoir. Elle maintient le statu quo. Celui qui contrôle la machine à assurer la sécurité ou l’insécurité contrôle le pouvoir réel. Le pouvoir n’hésite pas à manier son outil pour jongler entre la sécurité et l’insécurité. Son armée change souvent de casquette, soit pour assurer la sécurité , soit pour assurer l’insécurité. La sécurité des uns signifie souvent l’insécurité des autres, du moins au Burundi. Or, la sécurité est pour tout le monde et l’insécurité aussi. En mettant en pratique ces outils, le pouvoir commet un crime contre la société burundaise.
L’initiative privée : domaine réservé aux protégés du pouvoir
Dans un système d’exclusion, l’initiative privée a besoin d’une certaine protection à partir d’un certain niveau. Au Burundi, on parle d’opérateurs économiques, d’entrepreneurs ou de patrons. Je dirai que toute personne exerçant un métier à son compte est aussi un entrepreneur. Ainsi, les paysans burundais devraient porter le titre d’entrepreneurs comme leurs collègues français ou belges. De quel droit, le pouvoir burundais refuserait-il ce titre à nos travailleurs paysans, les privant ainsi d’accès au crédit?
Le marché burundais est dominé par l’Etat. Pour faire les affaires, il vaut mieux avoir les bonnes relations avec le pouvoir. Un entrepreneur privé est dépendant du pouvoir comme celui du public. Pour pouvoir importer, nos entrepreneurs ont besoin de devises. Elles ne s’achètent pas comme on le veut. Le pouvoir dispose de plusieurs coups de massue : l’accès aux devises, les contrôles fiscaux, l’élimination aux appels d’offres de marchés publics etc…
Le système bancaire burundais n’encourage pas les nouveaux arrivants moins nantis. Mieux vaut avoir les poches pleines que les projets bien faits. Le banquier ne prête qu’aux riches, disent les banquiers. Le pouvoir a le rôle d’encourager l’initiative privée par des outils financiers et d’expertise. Or, il préfère favoriser ses protégés que de lancer les « anonymes » qui ne seront pas reconnaissants.
Aide internationale : prix de la criminalisation socio-économique du pouvoir
Le Burundi est classé parmi les 3 derniers pays les plus pauvres de la planète terre. Il n’est pas pourtant parmi les 3 derniers ayant un parc automobile vétuste. L’aide internationale a contribué à la survie du pouvoir. Les fonds destinés au développement ont été détournés à d’autres fins. Une bonne partie a été utilisée pour l’achat des départements en Europe, en Afrique du Sud et à Bujumbura.
L’aide est destinée souvent au développement en général. Le gros de cette aide sert à financer le bataillon du personnel recruté pour le projet. Une bonne partie est affectée au fonctionnement (achats de voiture, téléphones etc…). Les bénéficiaires reçoivent rarement les miettes. Comment peut-on expliquer qu’un burundais, salarié d’un projet de développement, soit payé plus de 2 000 euros par mois alors que le ministre gagne moins de 500 euros? Que reste-t-il du financement direct du projet, des réalisations sur le terrain? Le rapport financement -réalisation sur le terrain est effrayant. On pourrait se demander si la paysannerie, le sida, la guerre ne sont aujourd’hui que le fond de commerce du pouvoir pour améliorer son train de vie.
Certains projets changent même d’objet. Un fond d’habitant rural finance aussi la construction des maisons dans la ville de Bujumbura. L’aide internationale en nature a cassé l’économie nationale dans une certaine mesure. Le riz « Not to be sold » concurrence le riz burundais sur le marché. Ce riz destiné à la population sinistrée se retrouve sur le marché et est vendu au prix inférieur au coût de production du riz local.
Conclusion :
La criminalisation socio-économique du pouvoir n’est pas l’apanage d’une seule ethnie ou d’une seule région. Le fond du problème reste le même tant que le principe de « ôte-toi de là que je m’y mette » continue à dominer. Le pouvoir pour se servir ne fera que fragiliser la cohésion nationale.
Au-delà des clichés ethniques, les pouvoirs successifs ont failli à leur mission et sont coupables du malheur du peuple burundais. Tous les prétextes sont bons pour trouver des excuses. Par ailleurs, les faits sont éloquents: les paysans sont exclus de la répartition, les détournements des fonds destinés au développement continuent etc…Toute solution de la question burundaise passe par une élimination de cette criminalisation socio-économique du pouvoir. Cette mission ne pourra être réalisée que par des burundais soucieux du bien-être du peuple.
Je vous remercie