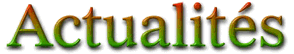
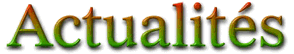
Par Nestor BIDADANURE
Burundi news, le 04/09/2012
LA CULTURE DE PAIX FACE AUX DERIVES IDENTITAIRES
A- LES PORTEURS D’ESPOIR
Honorables représentants de l’Etat ivoirien et de la société civile, honorables représentants de l’UNESCO et du CEPS ; distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Quels sont les fondements d’une Culture de paix susceptible de permettre un meilleur vivre ensemble dans des pays multiethniques et multiculturels, dont l’unité est menacée par l’intolérance identitaire ? Telle est dans une certaine mesure la question qui est posée à notre atelier. Avant de tenter d’y répondre, permettez-moi de commencer par rendre hommage à ces milliers de femmes et d’hommes qui, par leur comportement et leurs luttes quotidiennes, font que, dans une grande partie de l’Afrique, la diversité culturelle des peuples n’est pas source de conflits mais d’enrichissement mutuel. Car en effet, on ne le dit jamais assez, une culture de paix basée sur des modes de résolution pacifique des différends a été développée depuis des siècles par des Africains, et maintient à l’abri de la violence identitaire, des millions d’êtres humains. On ne saurait non plus oublier que même là où des guerres imposées par des élites extrémistes font rage, des résistances multiformes s’y déroulent pour dire non à la violence aveugle. « La barbarie de l’ignorance » que sont la haine et la violence contre l’autre, ne rencontre donc pas l’adhésion de l’ensemble des peuples et ne dispose pas du monopole de l’initiative. Notre contribution à ce forum serait défaitiste et souffrirait de manque d’humilité, si elle ignorait le combat de citoyens qui maintiennent la majeure partie du continent africain dans une certaine paix. Je dis bien une certaine paix, car l’absence de guerre dans un contexte où sévit la violence structurelle reste, hélas, une paix incomplète et fragile. Car tout être humain sans travail, sans logement, qui ne peut se soigner, sans perspective de vie meilleure pour lui-même et ses enfants, vit dans une insécurité permanente d’autant plus injuste que la plupart de nos pays ont les ressources nécessaires pour offrir une vie digne à chaque citoyen. Mais ici aussi, nous n’opérons pas sur un terrain vierge. Des acquis importants dans les domaines économique, éducationnel et culturel existent dans de nombreux pays africains grâce aux efforts des militants des sociétés civiles, ainsi que de certains dirigeants politiques qui assument leur rôle avec courage, sérieux et créativité. Ces femmes et hommes de paix ont eux-mêmes hérité leur conscience sociale humaniste, des générations qui les ont précédés dans des combats pour la justice et l’égalité entre les humains. Notre rôle aujourd’hui est donc de réfléchir à comment renforcer ces porteurs d’espérance.
Une telle démarche intellectuelle rentre en résonance avec la mission assignée à l’Unesco par les Nations-Unies au sortir de la Seconde guerre mondiale, et qu’aujourd’hui, il assume, en partenariat avec le Ceps : la solidarité intellectuelle et morale avec des peuples soumis aux affres de la guerre. Pour être efficace, la solidarité intellectuelle doit donc commencer par cultiver le discernement, démystifier une certaine représentation des crises africaines qui consiste à confondre ses effets et ses causes. Elle doit ensuite montrer qu’en enfourchant le cheval de l’identitaire, l’élite extrémiste africaine se trompe d’ennemi et se met elle-même en danger ; que la mission historique des intellectuels dignes de ce nom et des opérateurs économiques conséquents est de construire un environnement de paix durable qui, seul, est en mesure de garantir à l’ensemble des citoyens les conditions de leur épanouissement. Avant d’examiner en quoi les clefs constitutives de la culture de paix peuvent constituer des remparts contre les dérives identitaires, commençons donc par tenter de sortir de l’amalgame entre les effets et les causes des crises africaines.
B- LES CAUSES DES CRISES AFRICAINES SONT POLITIQUES.
Contrairement à l’idée répandue, les crises africaines ne sont par essence ni ethniques, ni religieuses encore moins régionales. Le caractère identitaire de ces crises résulte d’une stratégie politique des élites extrémistes. Il en est la conséquence, non la cause. Il suffit de s’intéresser de près au cas des conflits extrêmes, comme ceux qu’ont connus le Rwanda, le Burundi et aujourd’hui encore la Somalie, pour comprendre que ce qui est en jeu dans ces pays est le fait politique et non ethnique. Car faut-il rappeler que les Hutu, les Tutsi et les Twa au Rwanda et au Burundi parlent la même langue, ont la même culture et vivent entremêlés sur le même territoire. L’ethnie au sens de sa définition classique est donc introuvable dans ces pays ! Le cas de la Somalie est également de ce point de vue emblématique car ce pays est composé de près de 90 % de Somalis qui partagent la même culture, la même religion, l’Islam, et la même langue, le somali. Donc si la question des crises africaines avait pour cause la diversité ethnique et culturelle des peuples, il n’y aurait jamais eu de guerres aussi meurtrières dans ces trois pays. Rappelons-nous également que dans de nombreux pays africains, des peuples de cultures et de religions différentes vivent en bonne intelligence et ne connaissent pas la guerre. Ce qui veut donc dire que la diversité ne mène pas mécaniquement au conflit. Ce qui est en jeu n’est donc ici, ni l’absence, ni la présence des diversités au sein d’une société donnée, mais la volonté politique de diviser pour régner. C’est d’ailleurs pour cela que même là où les facteurs identitaires sont instrumentalisés par des groupes extrémistes, rien n’est non plus définitivement joué. Le changement de paradigme, par l’adoption d’une approche politique inclusive à l’issue d’un changement de pouvoir permet, progressivement, un retour à la paix. Il nous faut donc chercher les causes des guerres en Afrique en dehors de la fausse affirmation : diversité égale conflit. Il faut plutôt s’intéresser au fait politique qui se matérialise par l’instrumentalisation négative des différences, pour l’accès ou la conservation du pouvoir.
Ce qui est en cause ici, est en réalité l’idéologie fondée sur la haine de l’autre différent et qui, hélas, est loin d’être nouvelle dans l’histoire. Elle exprime le retour en force d’une triste et dangereuse idée de l’homme que l’on croyait dépassée : la politique de stigmatisation de l’autre pour ses origines réelles ou supposées et qui rime avec l’exclusion et la violence. La politique identitaire qui cible tel groupe ethnique, telle religion, les ressortissants de telle ou telle région, n’a cessé d’endeuiller l’Afrique postcoloniale. Elle est à l’opposé de l’idée humaniste qui croit dans le progrès de l’homme, car elle pense les différences comme figées et naturellement antagoniques. Elle dénie à l’identité humaine sa complexité, son héritage multiple et son caractère dynamique. Celle-ci devient réductible, selon les cas ; tantôt à la « race », tantôt à la religion, à l’ethnie ou la région. L’identitaire se construit contre le principe de citoyenneté, du fait qu’elle pense les différences humaines en termes d’inégalités immuables et en opposition à tout enrichissement mutuel.
La vision identitaire de la politique constitue une véritable régression par rapport aux luttes menées hier par les pères du panafricanisme pour l’émancipation des peuples africains. Elle est à rattacher aux courants idéologiques des siècles derniers qui pensaient la conscience humaine comme étant déterminée par la biologie. Elle divise et provoque des guerres dans des pays tant multiethniques qu’homogènes, mine les efforts d’intégration régionale et va contre toute idée d’unité dans la diversité du continent africain. Les partisans de l’identitaire voient la politique comme un moyen de conquête et de monopolisation du pouvoir, et l’humain comme un objet, un pion au service de l’objectif ultime. Le pouvoir et les avantages matériels et symboliques qu’il procure, constituent le but recherché, et aucun moyen pour l’obtenir n’est à exclure. Le sectarisme identitaire est pour certains un calcul politique cynique à court terme, et pour d’autres, une conviction manichéenne profonde. Nous sommes ici dans un contexte d’absence totale d'empathie, où règne la haine morbide de l’autre. Le sectarisme identitaire n’a pas besoin des différences réelles au sein d’une société donnée, pour légitimer son discours extrême. Quand elles y sont absentes, il les crée superficiellement comme le montre le cas du Rwanda et du Burundi. L’identitaire a pour stade ultime le génocide et finit par se retourner contre ses promoteurs. Il exprime une autre forme d’ignorance et de misère humaine, qui mérite plus d’investigation intellectuelle.
L’absurdité de l’identitaire peut aller jusqu’à déclarer un héros de l’indépendance nationale comme Kenneth Kaunda, ancien président de la Zambie, étranger dans le pays qu’il a lui-même mené à l’indépendance. Si, en Côte d’Ivoire Alassane Ouattara a été déclaré burkinabé par les partisans de l’ivoirité, le président de la RDC Joseph Kabila fut traité de rwandais par certains de ses opposants, nonobstant la réalité des faits. Car ici, on ne débat pas du meilleur programme politique susceptible de procurer la prospérité aux citoyens sans exclusive mais plutôt des « vrais » et des « faux » nationaux. Le présupposé qui se cache derrière la rationalité de l’identitaire est que les convictions des individus sont inséparables de leur origine. L’identitaire dénie à l’individu tout à la fois la capacité de construction de son libre arbitre et son appartenance à l’humanité. L’identitaire se manifeste également à travers une conception extrême de la religion qui se traduit par le rejet de toutes les autres : L’armée du seigneur ougandais, la LRA, d’obédience catholique, a pour projet de société les dix commandements bibliques. Dans le Sahel, au Nigéria et en Somalie, les mouvements fondamentalistes islamistes voient le coran et la charia comme la voie par excellence de la paix intégrale. La haine de celui qui ne pense pas et ne vit pas comme ces intégristes, justifie sa condamnation à mort ainsi que la destruction de son héritage culturel. Ces dérives identitaires, qu’elles prennent les formes ethniques ou religieuses, ou avancent sous le masque d’un régionalisme radical constituent un désastre pour l’Afrique. Elles fauchent des milliers de vies humaines, traumatisent la société et perpétuent la misère. Elles fragilisent les processus de création des ensembles régionaux, seules solutions viables pour la résolution des questions de développement et de la liberté de circulation des citoyens.
La haine de l’autre différent , fondée sur le fantasme d’appartenance à une religion, une ethnie, une race pure… est un défi lancé aux femmes et hommes épris de paix et de progrès aussi bien en Afrique que dans le monde. Il est donc urgent d’opposer à cette obscure culture de guerre et de malheur, une contre culture de paix ; une pensée ouverte, pragmatique, dont le contenu est en mesure de démystifier l’argumentaire identitaire et de proposer une issue au drame de la pauvreté. La Culture de Paix n’est pas un concept fermé, elle est en perpétuelle évolution. Elle ne peut, pour l’Afrique, se construire en dehors des expériences traditionnelles et modernes de résolution des conflits. Ouvrons donc quelques pistes de réflexions/solutions à partir des clefs constitutives de la Culture de paix.
C- QUELQUES CLEFS POUR UNE CULTURE DE PAIX
Se poser la question de la construction de la paix en Afrique , revient à se poser la question de ce que doit être l’antithèse d’une culture de guerre , véhiculée par des élites extrémistes à travers des discours identitaires, sectaires et violents. Cela amène également à s’interroger sur les fondements économiques et sociaux d’une paix durable dont la réconciliation est l'un des éléments importants. Analysons les clefs constitutives de la culture de paix en rapport avec la situation africaine :
1- Le respect de la vie, de la personne humaine et ses droits.
« Je suis parce que tu es » nous dit un proverbe africain. L’être humain est un être social avant tout. La souffrance de l’autre interpelle mon humanité. Je ne peux être indifférent à la violence et la pauvreté qui frappent autrui, sans que mon humanité en soit érodée. Le respect de la vie, de la personne humaine et de ses droits est aussi la condition du respect, par l’autre, de mes droits humains. On ne peut être libre tout seul dans un environnement de violence et de pauvreté générale. Etre libre est donc inséparable de l’engagement pour l’intérêt général. « Etre libre, nous dit Mandela, n’est pas simplement me débarrasser de mes chaînes » mais bien plus : « c’est vivre d’une manière qui renforce la liberté de l’autre ». Le respect de la vie et de la personne humaine signifie qu’aucune circonstance ne doit justifier l’usage des pratiques dégradantes contre l’autre. Toute sanction doit être conforme à la loi, pédagogique et respectueuse de la dignité des condamnés. La prison ne doit pas être le lieu de l’avilissement, une école de la violence mais le lieu d’étude et d’autodépassement pour le prisonnier. Au-delà de la sanction, la prison doit donc préparer les condamnés au retour dans la société, plus conscients de leur responsabilité citoyenne. Qui s’indigne contre l’injustice et la violence qui le touchent doit pareillement s’indigner contre les traitements dégradants contre les autres. Sinon, à quoi servirait notre indignation si nous étions le miroir du tortionnaire ?
2- L’accès des citoyens aux droits économiques et sociaux
Tout pouvoir qui ne cherche pas à garantir les droits économiques et sociaux de base aux catégories vulnérables exerce une violence sur une partie des membres de la société qui, dans certains cas, peut s’apparenter à la guerre. Il faut combattre l’intériorisation, chez une certaine élite, de l’idée que les pays africains ne peuvent pas accélérer le rythme de développement et vaincre la pauvreté. Car c’est entre autres cette vision pessimiste de l’avenir qui est la cause de l’exclusion sociale et des guerres. Celui qui se nourrit de la fausse idée que, dans son pays, les richesses sont insuffisantes donc limitées à quelques uns aura naturellement tendance à recourir à toutes les ruses pour exclure les autres de la course vers le pouvoir, pensé comme la seule source d’enrichissement. Il verra dans l’autre un ennemi à écarter de la route qui mène à ce qu’il considère comme les biens rares. Il faut donc réaffirmer de manière ferme qu’un pays non-industrialisé a l’avenir devant lui et qu’il ne saurait se développer sans l’usage rationnel de tous les citoyens instruits et non instruits ; que c’est le manque de vision, de volonté politique, ainsi que l’acceptation des mécanismes de gouvernance et de production archaïques qui pérennisent la pauvreté ; que la mise en place des équipes de réflexion/ action hautement qualifiées qui répertorieraient les expériences de développement endogènes, tant internes qu’externes, permettrait l’accélération de l’histoire en matière de développement. La mobilisation de toutes les intelligences et les bonnes volontés peuvent créer les conditions d’accès de toutes et tous aux droits humains. Et elles sont nombreuses les expériences de pays, pourtant moins favorisés par la nature, qui se sont rapidement développés. Ici le problème est donc la méconnaissance des voies et moyens de développement adaptés à nos pays et non un quelconque manque de solutions. Lutter pour la paix durable, c’est donc lutter contre la violence structurelle ainsi que l’ensemble des préjugés latents dans la société, qui mènent à la guerre. Nous ne devons surtout pas oublier que l’héroïsme ne se mesure pas en nombre de vies fauchées mais en nombre de vies sauvées. Garantir, pour tous, les droits humains signifie permettre de vivre dans la dignité à des millions d’individus qui, dans des circonstances de haine de l’autre, de faim et de guerre, meurent chaque jour d’une mort évitable.
3- LA RESOLUTION PACIFIQUE DES CONFLITS ET LA RECONCILIATION
Dans une grande partie de l’Afrique, les peuples issus d’ethnies différentes continuent de vivre en bonne intelligence. Ils ont développé ou hérité des mécanismes traditionnels de résolution des conflits et d’une vision du monde et de l’autre qui les mettent à l’abri des guerres identitaires. Chaque pays africain, sauf de rares exceptions, est une mosaïque de peuples, de cultures et de religions différentes. Les peuples africains parlent généralement deux à trois langues depuis la nuit des temps. Les interactions humaines ainsi que la nécessité de vivre ensemble avec l’autre différent, ont conduit les peuples à apprendre à accepter la différence avec autrui comme un enrichissement culturel, mais également comme la condition de la paix. Sans la volonté de vivre ensemble et l’art de la tolérance des différences avec ses voisins immédiats ou lointains, aucun royaume ni empire précolonial n’aurait pu exister. Nous aurions eu de menus territoires, composés de groupes ethniques ou claniques fragiles, et vivant en autarcie. Qui connaît l’histoire africaine d’ouverture à l’autre ne peut donc en son âme et conscience, oser enfourcher le cheval de la haine identitaire. De ce point de vue, le recours à l’identitaire est l’expression de la déconnection des élites extrémistes vis-à-vis de l’histoire de leur continent. De plus, de nouvelles identités émergent chaque jour du fait de l’urbanisation, de la mondialisation et du développement des nouvelles technologies de l’information. Le recueil et l’enseignement des fondements historiques de l’unité des états multiculturels et multiethniques, ainsi que l’ensemble des mécanismes, tant modernes que traditionnels de résolution pacifique des conflits, peuvent servir de fondement à une paix durable.
Une telle démarche peut montrer aux citoyens, que la réconciliation est l’affaire des visionnaires, des forts et surtout pas des faibles. Car il faut en effet faire preuve de courage et de lucidité pour ne pas réduire l’histoire d’un peuple à ses souffrances personnelles. Il faut du courage pour penser ses bourreaux comme des êtres qui gardent une part d’humanité, et peuvent s’émanciper de l’aveuglement meurtrier dont ils ont fait preuve. Dans les pays comme l’Afrique du Sud postapartheid, le Mozambique post-conflit ou le Rwanda post-génocide, des réflexions pertinentes sur le moyen de sortir de l’impasse de la violence extrême y ont été menées. Le développement d’un processus spécifique de résolution des conflits ne saurait méconnaître l’expérience des autres. Car derrière les différents processus de réconciliation se trouve une philosophie de la vie, des réflexions stratégiques tant modernes que traditionnelles de reconstruction de la paix pour les générations présentes et futures. Connaître les expériences des autres, n’impose en rien leur transfert mécanique dans des contextes différents. De même, la différence des situations n’en exclut pas les points de convergence. Mais toute réconciliation a un préalable qui s’appelle la vérité. Sans la reconnaissance de ses torts, il ne saurait y avoir de pardon ni de réconciliation. Mais peut-on pour autant tout pardonner ? Les crimes contre l’humanité échappent aujourd’hui à la compétence des instances juridiques et politiques d’un seul pays. Du fait que les crimes sont des crimes contre l’humanité, le pouvoir du pardon échappe également à la seule volonté de quelques individus et des dirigeants d’un seul pays. Par ailleurs, le pardon n’a de sens que si la mémoire reste vive. Le pardon ne saurait signifier oubli au risque de la répétition du crime.
4- L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES AINSI QUE L’INCLUSION DES DIVERSITES
L’égalité entre les hommes et les femmes doit se traduire par la parité. Car, la sous représentation des femmes au sein du pouvoir, est un acte d’injustice et de violence symbolique envers une partie de l’humanité. L’invisibilité ou la sous représentativité dans les instances dirigeantes des femmes, veut dire que leur identité les rend inférieures aux hommes. Mais au delà de la question du genre, il faut dire qu’il ne saurait y avoir de paix durable dans un pays où une partie des citoyens serait exclue du pouvoir, en raison de son identité. La stabilité des pays multiethniques et multiculturels dépend donc aussi de la politique inclusive des femmes et de toutes les diversités nationales. Car l’exclusion de l’autre différent, crée une identité d’exclu qui à la longue, peut constituer une source de conflit violent. Mais pour être effective, l’inclusion ne saurait se limiter au seul partage du pouvoir au sommet ; elle doit embrasser l’ensemble des instances d’un état et de la société. Elle doit s’inscrire dans une politique globale qui va du sommet à la base. La question de l’inclusion des diversités est également intimement liée à la lutte contre les exclusions sociales. Apprendre à penser la diversité comme une richesse, comme les couleurs de l’arc en ciel, tel est le rôle de l’éducation à la paix.
5- LA DEMOCRATIE ET LA LIBERTE D’EXPRESSION
Sans le droit d’élire ses dirigeants, on est objet dans l’histoire et non sujet. Les élections libres et démocratiques humanisent et responsabilisent, quand elles créent les conditions de réflexion, et que les citoyens élisent leurs représentants en leur âme et conscience : Ils deviennent ainsi des citoyens maîtres de leur destin. Mais on ne saurait oublier que de nombreux discours électoralistes, surfent sur la peur et la haine de l’autre. Ainsi l’exercice qui devrait être guidé par la noble mission de la politique - qui est la recherche du bonheur commun - se transforme en occasion de déstabilisation de la société. Là où les balises institutionnelles ne permettent pas de protéger la société contre la haine de l’autre, celle-ci s’impose dans le débat non pas comme un délit mais comme une opinion acceptable. Dans un tel contexte, certains médias peuvent être les facteurs amplificateurs de la haine dans la société. La violence symbolique des discours identitaires des politiques et des médias au Rwanda a eu pour résultat le génocide de 1994. Les notions d’ « ivoirité », de « congolité » ont été popularisées par les médias. Pourtant on ne peut imaginer une démocratie sans la liberté d’expression. Comment donc faire de la liberté de parole un instrument de paix et non de guerre ? Eduquer à la démocratie passe donc par la transmission des notions de discernement, et des valeurs humanistes de responsabilité envers la communauté humaine. Cela passe également par la formation des journalistes à ne plus penser l’information comme l’expression du seul malheur, mais aussi comme le fait de la résistance humaine et la victoire de la vie sur les forces de la haine et de l’exclusion. Car comment renforcer la culture de paix là où les médias ne montrent que la violence et la haine de l’autre et occultent, souvent inconsciemment, celles et ceux qui s’y opposent ? La démocratie doit être à la fois un instrument et un cadre de tolérance, d’inclusion, de développement et d’élévation de la pensée. Le degré de la vitalité d’une démocratie se mesure tout à la fois au niveau d’implication des citoyens dans les débats de société, à la qualité humaine de leurs propositions ainsi qu’à leur capacité de contrôle des politiques de leurs élus. Une démocratie qui n’a pas été dévoyée et vidée de son contenu ne peut ouvrir le chemin du pouvoir au dictat ethnique, religieux ou à un pouvoir xénophobe et corrompu. Car la démocratie est plus que le mode d’accès au pouvoir ; elle se vérifie dans le mode de gestion de celui-ci. La mise dans les urnes d’un bulletin pour le choix d’un élu n’est pas la fin du processus démocratique. C’est un début insuffisant qui doit être complété par la participation des citoyens à la définition, la mise en place et le contrôle de la politique qui les concerne.
6- LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
La pollution de l’environnement mène à des catastrophes « naturelles », à la désertification des sols et à des famines qui engendrent les conflits. Si bien que l’environnement ne peut plus être pensé comme un objet maniable à volonté. La négligence de celui-ci nous affecte. Nous ne pouvons plus nous penser comme les seuls êtres dignes de respect. Le respect de l’environnement est donc une question de sécurité et de responsabilité collective, mais également de philosophie de la vie. Nous sommes dans un rapport d’interdépendance physique et spirituel avec les arbres, la forêt, les océans, l’air et les animaux. Toute la matière qui compose notre organisme se trouve également dans notre environnement. Si bien que prendre soin de nous, veut aussi dire prendre soin de l’environnement. Planter les arbres, faire reculer le désert et réduire la pollution, c’est aussi permettre à des millions d’humains de vivre dans des conditions décentes.
EN GUISE DE CONCLUSION
La Culture de Paix doit être pensée et enseignée comme un idéal qui permet de relier et renforcer ce qui a été délié. C’est une théorie qui permet de penser les différences au sein d’une nation comme les couleurs de l’arc en ciel ; comme une précieuse richesse. Elle doit être une théorie de la démystification de l’identitaire et de rappel qu’il n’y a pas d’identité nationale hors la diversité tant culturelle qu’humaine de l’ensemble des citoyens. La Culture de Paix en Afrique de l’Ouest doit également opposer à la violence structurelle, la défense des droits humains, car c’est aussi la pauvreté qui sert de lit à la démagogie identitaire. « Les réalités d’aujourd’hui sont les utopies d’hier » disait Victor Hugo. Puisque la Culture de Paix est une utopie pragmatique, inclusive et profondément humaine, luttons pour qu’elle puisse être le plus rapidement possible la réalité de l’Afrique et la réalité du monde !
Nestor BIDADANURE.
Abidjan le 4 Juin 2012 :
Conférence internationale pour une Culture de paix en Afrique de l’Ouest.